J’ai pensé à vous car je vous avais entendu lors d’une brève intervention que vous aviez faite aux Papeteries de Cran (CITIA). Votre approche est atypique, vous mêlez le cinéma, la création, la technologie, la dimension sociale, la poésie comme le fait Carl Sagan dans Cosmos. La pensée de gens qui ne demeurent pas dans des cases, qui procèdent par associations d’idées est la plus intéressante. Nous pouvons parler de ce qui se passe en cette période, surtout de ce qu’elle suscite comme réflexions, comme analyses.
Je crois qu’on peut regarder les questions que soulève cette période sous l’angle du changement : qu’est-ce qui a déjà changé et qu’est-ce qui va changer ? La seconde question est très spéculative et dépendra beaucoup des horizons auxquels on se projette et des points du monde ou de la société que l’on observe, mais c’est évidemment ce que nous nous demandons tous.
Alors partons de ce qui a déjà changé.
Le principal constat pour moi c’est l’entrée par effraction du futur dans le présent. C’est ce qui a provoqué un état de vertige et de sidération, puis très vite le besoin de parler du monde d’après, puisqu’il est d’une certaine façon déjà advenu et s’impose ici à nous sous une forme insupportable. C’est ce que je me représente comme l’effraction du futur dans le présent.
Car si la causalité de l’épidémie que nous traversons ne peut pas nécessairement être réduite à une équation simplificatrice, par exemple « déforestation = épidémie », il ne fait pas de doute qu’on peut la rattacher à un système. Même si des épidémies se sont répandues à des époques où les dommages causés par nos civilisations à la nature, ou encore le niveau de connectivité de la planète étaient moindres qu’aujourd’hui, on ne doute pas qu’une économie destructrice, extractrice, mondialisée, spécialisée, hyperconnectée et interdépendante… constitue le terreau d’émergence et de propagation d’une pandémie comme celle-ci, et de celles qui adviendront quand ce virus aura muté ou qu’un autre apparaîtra.
Mais jusqu’ici, le niveau de conséquences que nous expérimentons en ce moment demeurait hypothétique. À l’occasion de la crise des Gilets Jaunes vous vous souvenez qu’on a beaucoup utilisé l’expression « problèmes de fin du monde contre problèmes de fins de mois ». Et la fin du monde ne nous semblait franchement pas programmée pour la fin du mois. Pour un jour d’accord, mais plus tard… Les plus conscients, souvent d’ailleurs les mieux informés, demeuraient minoritaires.
Cette fois donc, et d’un seul coup, un problème « du futur » explose dans notre présent à tous, et par « présent » j’entends ici notre quotidien, avec un impact direct, violent – et qui va durer – sur la vie de chacune et chacun d’entre nous quel que soit l’endroit sur la planète où nous vivions. Cela soumet à notre vécu immédiat des choses qui relevaient encore il y a peu dans nos esprits d’une forme d’abstraction parce qu’on avait beaucoup de mal à s’y projeter, même devant le spectacle apocalyptique des incendies australiens l’an dernier, ou la déforestation amazonienne ou les plastiques dans les océans et le reste, qui se conjuguent certes au présent mais pas au quotidien pour la plupart de nous, donc un présent lointain qu’on assimile à un futur.
Et voilà que demain est advenu aujourd’hui.
Personne n’a échappé ni n’échappera dans les mois qui viennent à ses conséquences. Tout ça engendre une énergie collective qui s’est amassée, et qui je l’espère se transformera en mouvement mais ça reste à écrire.
La 2e chose qui fait irruption est la notion de chaîne, chaîne de contamination, chaîne de propagation, avec la prise de conscience au quotidien de ce que veulent dire les croissances exponentielles. Avec l’épidémie nous avons pris la mesure de la capacité des hôpitaux, avec leurs moyens limités en dépit du dévouement, du courage et de l’imagination dont les soignants ont fait preuve, à faire croître la réponse thérapeutique, la réponse d’accueil, au même rythme que l’épidémie. Une organisation à croissance potentielle linéaire a dû faire face au développement exponentiel de l’épidémie. Et ça ne pouvait pas marcher, les deux échelles n’étaient pas commensurables, d’où la nécessité mondiale de ces opérations de confinement pour casser les courbes de contagion : aucune défense linéaire ne peut faire face à une menace exponentielle.
Cela nous fait expérimenter, par analogie, que la croissance vertigineuse de notre « consommation du monde » et de ses ressources, avec des doublements sur des cycles rapides, nous entraîne vers une destruction dont nous pouvons ressentir l’imminence aujourd’hui.
Voilà ce que j’observe et qui m’amène à beaucoup de questions. Que peut-on faire et que doit-on faire comme entrepreneur ou comme personne qui s’engage au quotidien dans des activités économiques ? Je mesure que c’est terriblement complexe !
Alors qu’est-ce qui va changer ? Vous parliez des horizons auxquels on se projette ou des points du monde que l’on observera… le monde d’après sera-t-il un patchwork d’une multitude de micro-mondes-d’après en perpétuel devenir ?
Là, pour moi, c’est un saut dans l’inconnu, et donc oui, c’est l’image la plus probable que je m’en fasse : un entrelacs d’expériences plus ou moins locales et plus ou moins globales, et des forces qui vont tirer dans tous les sens avec plus ou moins de succès et plus ou moins de persévérance… Quand j’ai dit ça je n’ai rien dit, mais au moins je pose l’idée que penser LE monde d’après est une impasse pour l’imagination comme en termes de stratégie de construction. C’est trop complexe, c’est inaccessible. C’est, littéralement, impensable.
J’observe dans le même temps que le Président de la République, lors de sa visite à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a salué « l’extraordinaire capacité [des personnels hospitaliers] à trouver des solutions en un temps record » et a constaté qu’il faut désormais qu’on trouve « d’autres modes de régulation qui partent DU BAS et du soin. »
Si on le fait vraiment, ça voudra dire que cette crise aura provoqué un renversement de perspective radical, un transfert de l’initiative, de la capacité d’imagination, de décision et d’action, à ceux qui sont au plus proche du réel, du terrain dans son acception la plus locale. Ça voudra dire aussi que chaque hôpital aura liberté, ou du moins une grande latitude à dessiner son propre monde d’après, sans que le même modèle s’applique nécessairement à tous. Ça demandera qu’ils soient maillés et qu’ils échangent leurs expériences, que beaucoup d’information circule. Je ne sais pas jusqu’où on ira sur ce chemin de liberté / responsabilité / communication et partage, mais ça me paraît prometteur.
Et beaucoup plus largement, ça devrait questionner dès à présent la gouvernance et l’organisation des entreprises – dont les plus grandes ! –, celles des collectivités, des quartiers, des communautés… L’énergie collective dont je parlais tout à l’heure, la conscience et l’envie me paraissent disponibles, mais je crois qu’elles ne produiront pas un mouvement mais des mouvements, avec plus ou moins de résultats et de bonheur selon les contextes, et beaucoup d’antagonismes globaux et locaux. Lors de nos échanges écrits en amont de cet entretien, vous avez évoqué deux idées intéressantes, le territoire et le digital. On voit bien qu’ils sont ici tous les deux impliqués.
Alors oui, je crois que le territoire et le digital sont deux sujets qui structureront le monde de demain. Mais pouvez-vous élaborer leur relation avec votre propos ?
À travers tout le XXe siècle on a « réduit » la planète à grands coups de vitesse et de transports, transports mécaniques d’une part et d’information d’autre part, laquelle est désormais temps réel et ubiquitaire. C’est ce qui a permis que le monde devienne global, que des zones entières se spécialisent dans certains types de productions, que d’autres s’en défassent complètement et que tout devienne interdépendant, renforçant en retour les transports comme fonction vitale et omniprésente de l’ensemble. C’est pourquoi nous dépensons autant d’énergie à déplacer toutes sortes de choses sur des distances énormes et des durées réduites : matières premières, marchandises, humains… On est devenu globaux parce qu’on le pouvait – et parce que le néolibéralisme le voulait mais d’abord parce qu’on le pouvait – n’oublions jamais ça. Désormais, seul ce que nous désirons devrait décider, et désirons-nous être, d’abord et avant tout, globaux et interdépendants ? Le local ne va plus accepter de se laisser noyer dans le global, je crois. C’est un point qui m’apparaît essentiel. Plus nos « territoires » rétréciront, plus chacun sera concerné, plus la multitude des intelligences sera mobilisée.
Quant au digital, qu’a-t-il permis au cœur de la crise et que permettra-t-il demain ? On a vu qu’il a permis la continuité de l’éducation, c’est à porter à son crédit parce que sans éducation, sans véritable « addiction au savoir » on est mort ! Il a permis la continuité des loisirs, on a vendu des tonnes de jeux vidéo, le doudou du confinement c’est « Animal Crossing », un jeu très paisible, rassurant, un jeu de liens amicaux. Et puis le numérique a permis la continuité du travail. Le télétravail est devenu un nouveau-normal-minute ! On a fait des nausées de Zoom. Et là, c’est une pièce à deux faces…
Je suis fan de télétravail sans doute parce que j’ai été beaucoup nomade et indépendant. Ces dernières années, j’ai laissé une grande liberté de télétravail aux collaborateurs de l’entreprise que je dirigeais, télétravail partiel, flexible, en fonction des circonstances. Ça s’est créé sur la confiance, ils s’y sont installés avec beaucoup de bien-être. Au début juste quelques personnes, puis l’habitude s’est développée, avec une grande autonomie mais sans jamais d’excès, avec souplesse et je crois productivité, en tout cas avec qualité de vie. Mais c’était un peu atypique.
Et ce printemps, en à peine quelques jours, 90% des employeurs se sont organisés pour y recourir, même les plus réticents ! Cette situation va prévaloir partout où c’est possible pendant encore de longs mois, et même après, des habitudes resteront prises. Alors, c’est bien non ?... C’est la vraie question : en est-on sûr ? À court terme beaucoup en ont souffert parce que le télétravail ajouté au confinement, souvent à la garde d’enfants, n’est pas une situation facile. Mais dans des conditions « normales », oui, les gens y trouvent généralement du confort et – je précise pour les patrons control-freaks – ça bénéficie à la qualité, à la créativité, aux relations internes… En revanche, si la rustine du télétravail nous permet de zapper en bloc toutes les questions qu’il faut désormais se poser sur le travail en tant que tel, alors on aura gâché une opportunité d’apprendre de cette crise. Car la vérité c’est que, aussi difficile cela soit-il, il faut écarquiller les yeux sur la nécessité de travailler infiniment moins, et de partager différemment une richesse différente, et de hiérarchiser différemment nos priorités, sinon on ne cassera pas la courbe de la consommation du monde.
Mais bien sûr, quand on se projette dans un avenir où l’on travaille infiniment moins, l’imagination est sacrément mise à défi, et du coup il ne reste plus grand-monde pour s’y atteler. Donc il y a de grandes chances que le télétravail se contente d’incarner la valeur cardinale du système actuel : grâce à lui on peut continuer à produire. Et tant que nous pouvons continuer à produire, nous pouvons générer de la croissance, génial, de la consumation exponentielle de ressources et des déchets, moins génial. Si c’est ce qui doit advenir, alors le digital n’aura fait que masquer les problèmes qui sont un cran derrière.
Je crois qu’on peut regarder les questions que soulève cette période sous l’angle du changement : qu’est-ce qui a déjà changé et qu’est-ce qui va changer ? La seconde question est très spéculative et dépendra beaucoup des horizons auxquels on se projette et des points du monde ou de la société que l’on observe, mais c’est évidemment ce que nous nous demandons tous.
Alors partons de ce qui a déjà changé.
Le principal constat pour moi c’est l’entrée par effraction du futur dans le présent. C’est ce qui a provoqué un état de vertige et de sidération, puis très vite le besoin de parler du monde d’après, puisqu’il est d’une certaine façon déjà advenu et s’impose ici à nous sous une forme insupportable. C’est ce que je me représente comme l’effraction du futur dans le présent.
Car si la causalité de l’épidémie que nous traversons ne peut pas nécessairement être réduite à une équation simplificatrice, par exemple « déforestation = épidémie », il ne fait pas de doute qu’on peut la rattacher à un système. Même si des épidémies se sont répandues à des époques où les dommages causés par nos civilisations à la nature, ou encore le niveau de connectivité de la planète étaient moindres qu’aujourd’hui, on ne doute pas qu’une économie destructrice, extractrice, mondialisée, spécialisée, hyperconnectée et interdépendante… constitue le terreau d’émergence et de propagation d’une pandémie comme celle-ci, et de celles qui adviendront quand ce virus aura muté ou qu’un autre apparaîtra.
Mais jusqu’ici, le niveau de conséquences que nous expérimentons en ce moment demeurait hypothétique. À l’occasion de la crise des Gilets Jaunes vous vous souvenez qu’on a beaucoup utilisé l’expression « problèmes de fin du monde contre problèmes de fins de mois ». Et la fin du monde ne nous semblait franchement pas programmée pour la fin du mois. Pour un jour d’accord, mais plus tard… Les plus conscients, souvent d’ailleurs les mieux informés, demeuraient minoritaires.
Cette fois donc, et d’un seul coup, un problème « du futur » explose dans notre présent à tous, et par « présent » j’entends ici notre quotidien, avec un impact direct, violent – et qui va durer – sur la vie de chacune et chacun d’entre nous quel que soit l’endroit sur la planète où nous vivions. Cela soumet à notre vécu immédiat des choses qui relevaient encore il y a peu dans nos esprits d’une forme d’abstraction parce qu’on avait beaucoup de mal à s’y projeter, même devant le spectacle apocalyptique des incendies australiens l’an dernier, ou la déforestation amazonienne ou les plastiques dans les océans et le reste, qui se conjuguent certes au présent mais pas au quotidien pour la plupart de nous, donc un présent lointain qu’on assimile à un futur.
Et voilà que demain est advenu aujourd’hui.
Personne n’a échappé ni n’échappera dans les mois qui viennent à ses conséquences. Tout ça engendre une énergie collective qui s’est amassée, et qui je l’espère se transformera en mouvement mais ça reste à écrire.
La 2e chose qui fait irruption est la notion de chaîne, chaîne de contamination, chaîne de propagation, avec la prise de conscience au quotidien de ce que veulent dire les croissances exponentielles. Avec l’épidémie nous avons pris la mesure de la capacité des hôpitaux, avec leurs moyens limités en dépit du dévouement, du courage et de l’imagination dont les soignants ont fait preuve, à faire croître la réponse thérapeutique, la réponse d’accueil, au même rythme que l’épidémie. Une organisation à croissance potentielle linéaire a dû faire face au développement exponentiel de l’épidémie. Et ça ne pouvait pas marcher, les deux échelles n’étaient pas commensurables, d’où la nécessité mondiale de ces opérations de confinement pour casser les courbes de contagion : aucune défense linéaire ne peut faire face à une menace exponentielle.
Cela nous fait expérimenter, par analogie, que la croissance vertigineuse de notre « consommation du monde » et de ses ressources, avec des doublements sur des cycles rapides, nous entraîne vers une destruction dont nous pouvons ressentir l’imminence aujourd’hui.
Voilà ce que j’observe et qui m’amène à beaucoup de questions. Que peut-on faire et que doit-on faire comme entrepreneur ou comme personne qui s’engage au quotidien dans des activités économiques ? Je mesure que c’est terriblement complexe !
Alors qu’est-ce qui va changer ? Vous parliez des horizons auxquels on se projette ou des points du monde que l’on observera… le monde d’après sera-t-il un patchwork d’une multitude de micro-mondes-d’après en perpétuel devenir ?
Là, pour moi, c’est un saut dans l’inconnu, et donc oui, c’est l’image la plus probable que je m’en fasse : un entrelacs d’expériences plus ou moins locales et plus ou moins globales, et des forces qui vont tirer dans tous les sens avec plus ou moins de succès et plus ou moins de persévérance… Quand j’ai dit ça je n’ai rien dit, mais au moins je pose l’idée que penser LE monde d’après est une impasse pour l’imagination comme en termes de stratégie de construction. C’est trop complexe, c’est inaccessible. C’est, littéralement, impensable.
J’observe dans le même temps que le Président de la République, lors de sa visite à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a salué « l’extraordinaire capacité [des personnels hospitaliers] à trouver des solutions en un temps record » et a constaté qu’il faut désormais qu’on trouve « d’autres modes de régulation qui partent DU BAS et du soin. »
Si on le fait vraiment, ça voudra dire que cette crise aura provoqué un renversement de perspective radical, un transfert de l’initiative, de la capacité d’imagination, de décision et d’action, à ceux qui sont au plus proche du réel, du terrain dans son acception la plus locale. Ça voudra dire aussi que chaque hôpital aura liberté, ou du moins une grande latitude à dessiner son propre monde d’après, sans que le même modèle s’applique nécessairement à tous. Ça demandera qu’ils soient maillés et qu’ils échangent leurs expériences, que beaucoup d’information circule. Je ne sais pas jusqu’où on ira sur ce chemin de liberté / responsabilité / communication et partage, mais ça me paraît prometteur.
Et beaucoup plus largement, ça devrait questionner dès à présent la gouvernance et l’organisation des entreprises – dont les plus grandes ! –, celles des collectivités, des quartiers, des communautés… L’énergie collective dont je parlais tout à l’heure, la conscience et l’envie me paraissent disponibles, mais je crois qu’elles ne produiront pas un mouvement mais des mouvements, avec plus ou moins de résultats et de bonheur selon les contextes, et beaucoup d’antagonismes globaux et locaux. Lors de nos échanges écrits en amont de cet entretien, vous avez évoqué deux idées intéressantes, le territoire et le digital. On voit bien qu’ils sont ici tous les deux impliqués.
Alors oui, je crois que le territoire et le digital sont deux sujets qui structureront le monde de demain. Mais pouvez-vous élaborer leur relation avec votre propos ?
À travers tout le XXe siècle on a « réduit » la planète à grands coups de vitesse et de transports, transports mécaniques d’une part et d’information d’autre part, laquelle est désormais temps réel et ubiquitaire. C’est ce qui a permis que le monde devienne global, que des zones entières se spécialisent dans certains types de productions, que d’autres s’en défassent complètement et que tout devienne interdépendant, renforçant en retour les transports comme fonction vitale et omniprésente de l’ensemble. C’est pourquoi nous dépensons autant d’énergie à déplacer toutes sortes de choses sur des distances énormes et des durées réduites : matières premières, marchandises, humains… On est devenu globaux parce qu’on le pouvait – et parce que le néolibéralisme le voulait mais d’abord parce qu’on le pouvait – n’oublions jamais ça. Désormais, seul ce que nous désirons devrait décider, et désirons-nous être, d’abord et avant tout, globaux et interdépendants ? Le local ne va plus accepter de se laisser noyer dans le global, je crois. C’est un point qui m’apparaît essentiel. Plus nos « territoires » rétréciront, plus chacun sera concerné, plus la multitude des intelligences sera mobilisée.
Quant au digital, qu’a-t-il permis au cœur de la crise et que permettra-t-il demain ? On a vu qu’il a permis la continuité de l’éducation, c’est à porter à son crédit parce que sans éducation, sans véritable « addiction au savoir » on est mort ! Il a permis la continuité des loisirs, on a vendu des tonnes de jeux vidéo, le doudou du confinement c’est « Animal Crossing », un jeu très paisible, rassurant, un jeu de liens amicaux. Et puis le numérique a permis la continuité du travail. Le télétravail est devenu un nouveau-normal-minute ! On a fait des nausées de Zoom. Et là, c’est une pièce à deux faces…
Je suis fan de télétravail sans doute parce que j’ai été beaucoup nomade et indépendant. Ces dernières années, j’ai laissé une grande liberté de télétravail aux collaborateurs de l’entreprise que je dirigeais, télétravail partiel, flexible, en fonction des circonstances. Ça s’est créé sur la confiance, ils s’y sont installés avec beaucoup de bien-être. Au début juste quelques personnes, puis l’habitude s’est développée, avec une grande autonomie mais sans jamais d’excès, avec souplesse et je crois productivité, en tout cas avec qualité de vie. Mais c’était un peu atypique.
Et ce printemps, en à peine quelques jours, 90% des employeurs se sont organisés pour y recourir, même les plus réticents ! Cette situation va prévaloir partout où c’est possible pendant encore de longs mois, et même après, des habitudes resteront prises. Alors, c’est bien non ?... C’est la vraie question : en est-on sûr ? À court terme beaucoup en ont souffert parce que le télétravail ajouté au confinement, souvent à la garde d’enfants, n’est pas une situation facile. Mais dans des conditions « normales », oui, les gens y trouvent généralement du confort et – je précise pour les patrons control-freaks – ça bénéficie à la qualité, à la créativité, aux relations internes… En revanche, si la rustine du télétravail nous permet de zapper en bloc toutes les questions qu’il faut désormais se poser sur le travail en tant que tel, alors on aura gâché une opportunité d’apprendre de cette crise. Car la vérité c’est que, aussi difficile cela soit-il, il faut écarquiller les yeux sur la nécessité de travailler infiniment moins, et de partager différemment une richesse différente, et de hiérarchiser différemment nos priorités, sinon on ne cassera pas la courbe de la consommation du monde.
Mais bien sûr, quand on se projette dans un avenir où l’on travaille infiniment moins, l’imagination est sacrément mise à défi, et du coup il ne reste plus grand-monde pour s’y atteler. Donc il y a de grandes chances que le télétravail se contente d’incarner la valeur cardinale du système actuel : grâce à lui on peut continuer à produire. Et tant que nous pouvons continuer à produire, nous pouvons générer de la croissance, génial, de la consumation exponentielle de ressources et des déchets, moins génial. Si c’est ce qui doit advenir, alors le digital n’aura fait que masquer les problèmes qui sont un cran derrière.
Mais alors comment relever le défi d’imagination que suppose un monde durable ?
Changer de modes de vie, changer nos raisons d’agir et nos motivations à l’échelle du monde, c'est compliqué, et tout ça pour aller où ? Il nous manque le grand récit, je crois, celui qu’on peut regarder ensemble et qui raconte autre chose que « travailler pour consommer et advienne que pourra », qui est la version à peine caricaturale de celui dans lequel nous baignons.
Avec Éric Viennot, un ami et game designer réputé pour l’originalité de son travail et le sens de ce qu’il y exprime, nous pensons que la crise du coronavirus donne corps de manière à la fois brutale et tangible à l’idée d’une communauté de destin de l’humanité. Et au-delà, à celle d’une communauté de destin planétaire. Mais les récits du futur susceptibles de faire regarder l’humanité, au-delà des frontières et des intérêts corporatistes ou de classes, dans des directions qui ne la conduisent pas au précipice, manquent cruellement aujourd’hui. Yuval Noah Harari souligne que le seul à avoir résisté aux drames du XXe siècle est celui, désormais sans concurrence, du capitalisme libéral. Celui qui nous a conduits, justement, aux catastrophes contemporaines et dont on est fondé à douter qu’il en devienne soudainement le remède.
Alors il faut d’urgence engendrer ces récits. Les engendrer et les adopter de manière collective et ouverte. Ça nous paraît, à Éric et moi, la seule façon de créer un futur alternatif à celui qui nous semble à ce jour tragiquement assigné.
Mais comment ? À travers quel média ? Nous ne sommes plus à l’âge de Gutenberg ou à celui de McLuhan. Nous vivons dans un monde façonné par Internet et par Facebook, dans un imaginaire colporté par l’image et par l’interactivité. Nous sommes plongés dans une culture d’engagement et d’impact. Les diagnostics ne suffiront pas, les lancements d’alertes ne suffiront pas, les formats intellectuels classiques (rapports, études, livres, articles, discours et même films…) ne suffiront pas.
À nos yeux, le jeu vidéo est probablement l’art, à la fois créatif et technologique, le plus à même de s’emparer de cette mission et de donner vie et forme au grand récit collectif que nous devons faire naître et nous donner pour boussole. Si la communauté du jeu vidéo s’emparait de cette mission vitale, à travers la création d’un grand monde persistant en ligne, massivement multijoueur, où toutes nos interactions manifesteraient sous nos yeux le futur probable qui en résulterait, il nous semble que justement nous ouvririons les yeux, collectivement.
Changer de modes de vie, changer nos raisons d’agir et nos motivations à l’échelle du monde, c'est compliqué, et tout ça pour aller où ? Il nous manque le grand récit, je crois, celui qu’on peut regarder ensemble et qui raconte autre chose que « travailler pour consommer et advienne que pourra », qui est la version à peine caricaturale de celui dans lequel nous baignons.
Avec Éric Viennot, un ami et game designer réputé pour l’originalité de son travail et le sens de ce qu’il y exprime, nous pensons que la crise du coronavirus donne corps de manière à la fois brutale et tangible à l’idée d’une communauté de destin de l’humanité. Et au-delà, à celle d’une communauté de destin planétaire. Mais les récits du futur susceptibles de faire regarder l’humanité, au-delà des frontières et des intérêts corporatistes ou de classes, dans des directions qui ne la conduisent pas au précipice, manquent cruellement aujourd’hui. Yuval Noah Harari souligne que le seul à avoir résisté aux drames du XXe siècle est celui, désormais sans concurrence, du capitalisme libéral. Celui qui nous a conduits, justement, aux catastrophes contemporaines et dont on est fondé à douter qu’il en devienne soudainement le remède.
Alors il faut d’urgence engendrer ces récits. Les engendrer et les adopter de manière collective et ouverte. Ça nous paraît, à Éric et moi, la seule façon de créer un futur alternatif à celui qui nous semble à ce jour tragiquement assigné.
Mais comment ? À travers quel média ? Nous ne sommes plus à l’âge de Gutenberg ou à celui de McLuhan. Nous vivons dans un monde façonné par Internet et par Facebook, dans un imaginaire colporté par l’image et par l’interactivité. Nous sommes plongés dans une culture d’engagement et d’impact. Les diagnostics ne suffiront pas, les lancements d’alertes ne suffiront pas, les formats intellectuels classiques (rapports, études, livres, articles, discours et même films…) ne suffiront pas.
À nos yeux, le jeu vidéo est probablement l’art, à la fois créatif et technologique, le plus à même de s’emparer de cette mission et de donner vie et forme au grand récit collectif que nous devons faire naître et nous donner pour boussole. Si la communauté du jeu vidéo s’emparait de cette mission vitale, à travers la création d’un grand monde persistant en ligne, massivement multijoueur, où toutes nos interactions manifesteraient sous nos yeux le futur probable qui en résulterait, il nous semble que justement nous ouvririons les yeux, collectivement.
Articles similaires...
-
 Comment se former pour devenir DJ et mixer en soirée ?
Comment se former pour devenir DJ et mixer en soirée ?
-
 Le Retour de "Friends Experience" à Paris : Une Plongée dans l'Univers de la Série Culte
Le Retour de "Friends Experience" à Paris : Une Plongée dans l'Univers de la Série Culte
-
 L’AirOtic Soirée à Paris : un spectacle renversant !
L’AirOtic Soirée à Paris : un spectacle renversant !
-
 Bubble Planet à Bruxelles : Une aventure immersive hors du commun
Bubble Planet à Bruxelles : Une aventure immersive hors du commun
-
 La Forêt Interdite d'Harry Potter s’invite à Toulouse
La Forêt Interdite d'Harry Potter s’invite à Toulouse
La force du jeu vidéo est double : sa puissance narrative et expressive, seule à même de faire partager à des millions d’humains la question du comment vivre et la réalité de nos destins individuels, et sa formidable capacité à modéliser et faire évoluer des mondes virtuels complexes. Le jeu vidéo ne choisit pas entre l’expérience captivante et la dramaturgie d’une part, la scientificité des modèles d’autre part. Il est la seule forme d’expression qui depuis 40 ans a toujours voulu le meilleur de ces deux espaces. Il égale voire dépasse la capacité narrative du cinéma, en lui ajoutant l’immersion, et dans le même temps, ses modèles de simulation physiques ou logiques sont à la pointe de l’état de l’art scientifique.
Si un tel jeu existait, où des millions de personnes décident quant aux façons de vivre, de travailler, de consommer, de répartir, etc., et que chacune de ces décisions vienne alimenter des modèles énergétiques, climatiques, économiques, financiers, démographiques… mais aussi de simulation de vie, de santé, d’éducation, d’épanouissement des individus… on sortirait de l’abstraction. On toucherait du doigt l’émergence de futurs possibles comme conséquences de la somme de nos actes, et leurs conséquences en retour dans la transformation de nos vies.
Ce qui nous paraît passionnant dans cette idée telle que nous l’imaginons, c’est la possibilité d’une intelligence collective à plusieurs étages : d’abord tous les joueurs désireux d’exprimer leur voix, de faire des choix et de s’engager, c’est-à-dire de faire des « promesses de comportements », comme au Téléthon on fait des promesses de dons et qu’ensuite, dans la vraie vie, on les honore, mais en complément de ces joueurs, une communauté de scientifiques et d’experts, de chercheurs et d’organisations détentrices de modèles de simulation ou de projection. Nous pensons à Gaël Giraud par exemple, une des voix originales et visionnaires qui s’expriment en France dans le champ de l’économie de la transition énergétique. Durant les années où il était chef économiste à l’Agence Française de Développement, il a développé avec son équipe un outil de modélisation appelé GEMMES (General Monetary and Multisectoral Macrodynamics for the Ecological Shift). Pourquoi ne pas envisager de connecter ce type de modèle, et de nombreux autres, avec l’accord et le soutien de leurs auteurs bien entendu, à l’architecture générale du système ? Pourquoi ne pas proposer à toutes ces équipes scientifiques et de recherche, d’utiliser Second Future – c’est le nom que nous lui donnons pour l’instant – comme un espace d’expérimentation, massivement générateur de données et d’interactions entre une multitude d’agents ?
On pourrait faire ainsi de Second Future la synthèse de nos projections les plus avancées et rationnelles, pour sortir des croyances qui prospèrent sur le terreau de l’ignorance, ou du simple désintérêt « parce que c’est trop compliqué », « parce qu’on n’y peut rien », « parce que c’est foutu d’avance »… Mais on n’arrivera à rien avec des récits d’apocalypses, nos cerveaux ne sont pas faits pour ça, on a besoin de futurs désirables, qui nous donnent envie d’aller vers eux avec le sentiment que c’est possible et que tout ça n’est pas pour rien. Bref, que c’est encore jouable ! Et pour que l’avenir reste jouable, nous pensons qu’il faut commencer par le rendre, au sens propre, jouable dans un jeu. Donc ne pas en faire seulement un objet scientifique, mais un espace narratif et ludique, attrayant et positivement addictif, tout ce que sait faire le jeu vidéo.
Éric et moi avons cette idée dans un coin de notre tête. C’est quelque chose d’évidemment très ambitieux, qui ne pourrait être porté que par une communauté tout entière, mais le moment est assez grave pour ne pas baisser les yeux ou pire, s’interdire de rêver. Il faut créer des chaînes de conscientisation et d’engagement. Il faut une épidémie de prise de conscience, des visions partagées des innombrables possibilités de futurs vers lesquels nous pouvons encore nous orienter, alors que nous gardons pour la plupart le nez dans nos problèmes quotidiens : « Est-ce que je pourrai prendre l’avion cet été pour partir en vacances ? » Ce n’est pas avec ce niveau d’horizon qu’on atterrira quelque part.
Si un tel jeu existait, où des millions de personnes décident quant aux façons de vivre, de travailler, de consommer, de répartir, etc., et que chacune de ces décisions vienne alimenter des modèles énergétiques, climatiques, économiques, financiers, démographiques… mais aussi de simulation de vie, de santé, d’éducation, d’épanouissement des individus… on sortirait de l’abstraction. On toucherait du doigt l’émergence de futurs possibles comme conséquences de la somme de nos actes, et leurs conséquences en retour dans la transformation de nos vies.
Ce qui nous paraît passionnant dans cette idée telle que nous l’imaginons, c’est la possibilité d’une intelligence collective à plusieurs étages : d’abord tous les joueurs désireux d’exprimer leur voix, de faire des choix et de s’engager, c’est-à-dire de faire des « promesses de comportements », comme au Téléthon on fait des promesses de dons et qu’ensuite, dans la vraie vie, on les honore, mais en complément de ces joueurs, une communauté de scientifiques et d’experts, de chercheurs et d’organisations détentrices de modèles de simulation ou de projection. Nous pensons à Gaël Giraud par exemple, une des voix originales et visionnaires qui s’expriment en France dans le champ de l’économie de la transition énergétique. Durant les années où il était chef économiste à l’Agence Française de Développement, il a développé avec son équipe un outil de modélisation appelé GEMMES (General Monetary and Multisectoral Macrodynamics for the Ecological Shift). Pourquoi ne pas envisager de connecter ce type de modèle, et de nombreux autres, avec l’accord et le soutien de leurs auteurs bien entendu, à l’architecture générale du système ? Pourquoi ne pas proposer à toutes ces équipes scientifiques et de recherche, d’utiliser Second Future – c’est le nom que nous lui donnons pour l’instant – comme un espace d’expérimentation, massivement générateur de données et d’interactions entre une multitude d’agents ?
On pourrait faire ainsi de Second Future la synthèse de nos projections les plus avancées et rationnelles, pour sortir des croyances qui prospèrent sur le terreau de l’ignorance, ou du simple désintérêt « parce que c’est trop compliqué », « parce qu’on n’y peut rien », « parce que c’est foutu d’avance »… Mais on n’arrivera à rien avec des récits d’apocalypses, nos cerveaux ne sont pas faits pour ça, on a besoin de futurs désirables, qui nous donnent envie d’aller vers eux avec le sentiment que c’est possible et que tout ça n’est pas pour rien. Bref, que c’est encore jouable ! Et pour que l’avenir reste jouable, nous pensons qu’il faut commencer par le rendre, au sens propre, jouable dans un jeu. Donc ne pas en faire seulement un objet scientifique, mais un espace narratif et ludique, attrayant et positivement addictif, tout ce que sait faire le jeu vidéo.
Éric et moi avons cette idée dans un coin de notre tête. C’est quelque chose d’évidemment très ambitieux, qui ne pourrait être porté que par une communauté tout entière, mais le moment est assez grave pour ne pas baisser les yeux ou pire, s’interdire de rêver. Il faut créer des chaînes de conscientisation et d’engagement. Il faut une épidémie de prise de conscience, des visions partagées des innombrables possibilités de futurs vers lesquels nous pouvons encore nous orienter, alors que nous gardons pour la plupart le nez dans nos problèmes quotidiens : « Est-ce que je pourrai prendre l’avion cet été pour partir en vacances ? » Ce n’est pas avec ce niveau d’horizon qu’on atterrira quelque part.
 Un Concept
Un Concept













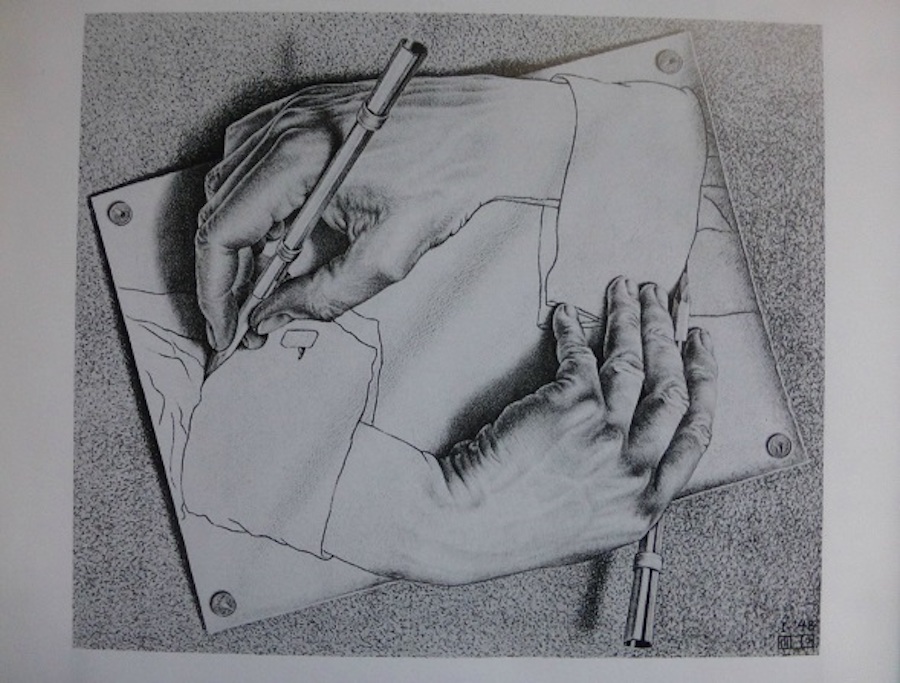
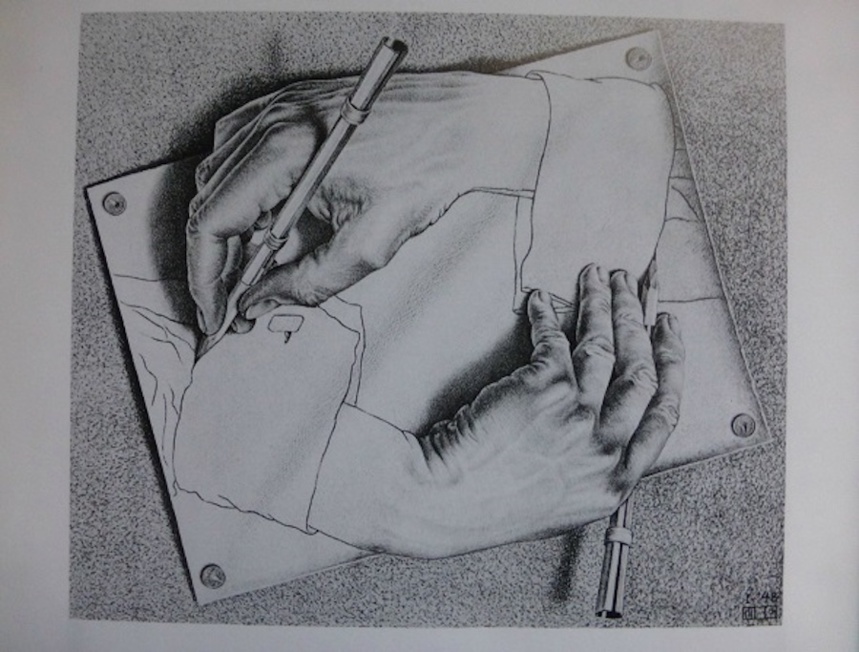






 < Page PDF
< Page PDF
















